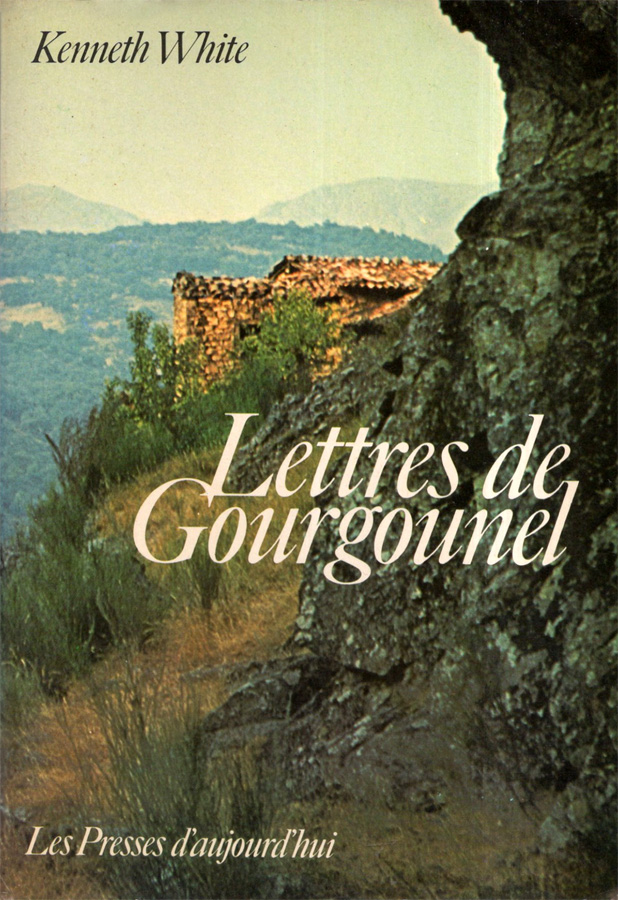Récits
Lettres de Gourgounel
Traduction Marie-Claude White
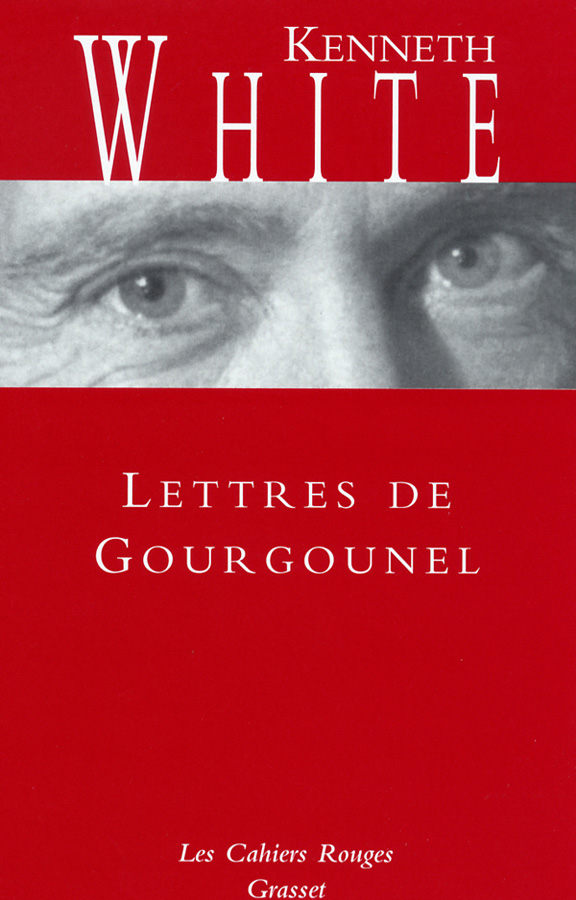
Le Livre
1986
Récit
19 x 12 cm
196 pages
Livre broché
ISBN 9782246368724
Première édition : Presses d’aujourd’hui 1979
Éditions Grasset, Paris
Me sentant, à une certaine époque, « exilé » comme le vieux Lieu Tsong-yuan, et seul comme un rhinocéros, j’avais cherché un lieu désert où concentrer, du moins pour un temps, ma vie et ma pensée. Je l’ai trouvé là en Ardèche, plus précisément au hameau des Praduches, au lieu-dit Gourgounel (ça gargouillait, ça parlait le langage des sources). En ce temps-là, l’Ardèche faisait encore partie du « désert français », et je connaissais à peine son existence. J’avais tout au plus quelques vagues souvenirs du voyage dans les Cévennes de mon compatriote Stevenson et j’avais lu dans une biographie de Mallarmé qu’il y avait enseigné un temps l’anglais. Selon Mallarmé, le nom du pays résumait sa vie : l’art et la dèche. Non pas que ce livre soit en quoi que ce soit mallarméen. Il constitue même un effort pour présenter un espace et une manière d’être au monde complètement différents de « l’espace littéraire » qui est, en France, le legs de Mallarmé. Il n’est pas « stevensonien » non plus. Il se veut moins gentil et esthétique que Stevenson, plus ouvert à des vents fous, avec de l’orage dans l’air et des lumières inédites. Comment qualifier l’espace de ce livre ? Je n’en sais trop rien. J’aimerais seulement qu’on y trouve la saveur du réel, et une poésie rude, sans affectation, sans complication inutile. « Nous voulons être les poètes de notre vie », disait Nietzsche, qui constitue la porte occidentale de ce livre, comme Tchouang-tseu en est la porte orientale.
Préface de l’auteur .
Extrait
Je m’endors au son du tonnerre, et je m’éveille au son du tonnerre. Le ciel est gris et noir ; les forêts sont vertes, d’un vert presque noir lui aussi. Je n’ai plus besoin de me laver : le matin, il me suffit de faire un pas au-dehors et de rester nu un moment, debout sous la pluie. Puis je rentre dans la maison, je me frictionne de la tête aux pieds, et, tirant ma chaise contre la maie, je me mets à méditer. En général, il fait jour à demi, et je n’y vois qu’à peine. J’allume parfois une bougie ; d’autres fois, je me contente d’attendre jusqu’à ce qu’il y ait assez de lumière. Ce matin, vers cinq heures, il y avait un pic-vert dans les mûriers. J’ignore si c’est là un signe reconnu, mais il me semblait qu’il appelait le tonnerre. Le Tanargue lui répondit un tout petit peu plus tard. Les Cévennes tout entières tourbillonnent sous les orages.
Extrait du chapitre « Notes cimmériennes »
Lire « Post-scriptum de Gourgounel » de Stéphane Bigeard, La Revue des ressources.
Première édition, 1979